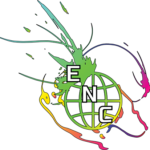La question de la couleur, centrale dans la théorie classique de la connaissance, ne cesse de hanter la pensée, à travers ses configurations multiples qui tournent toujours autour de la question de la chose en soi. Soit tout est apparence, ce qui condamne les sens comme les concepts à s’en tenir à une représentation partielle du monde, soit on propose une hiérarchisation entre qualités secondes et qualités premières, ces dernières donnant seules accès à l’être véritable de la chose. Tout au plus peut-on tenter de sortir du dilemme perpétuel et esquisser une position mitigée, qui n’est pas loin de retrouver celle de Locke, tel qu’elle est reprise aujourd’hui par Colin Mac Ginn dans The subjective view (1982) ; celle-ci réaffirme le statut de qualité seconde des couleurs : être rouge c’est seulement paraître rouge pour un sujet, car les électrons du corps rouge ne sont pas rouges. Mais une telle proposition n’autorise pas à dissoudre l’objet par un seul subjectivisme. Les objets comportent bien des dispositions intrinsèques à produire certains effets empiriques, de sorte que nous percevons bien les objets eux-mêmes et non leur représentation mentale en nous. La discontinuité entre qualités premières et secondes ne les rend pas moins inséparables. La couleur, entre autres, est « un intermédiaire grâce auquel le monde extérieur et l’esprit peuvent entrer en contact ». (Quilliot, 1993, p. 189)
Il reste que globalement la phénoménalité colorée se trouve réinvestie aujourd’hui d’un mode de présence de la chose, qui ne nécessite aucun énoncé métaphysique sur son ontologie. La phénoménologie sauve ainsi le sensible, en particulier les couleurs, pour les restaurer dans leur plénitude phénoménale dans l’apparition ( Erscheinung ) originaire du monde. Ce retour aux data sensibles fait ainsi contrepoids, d’une certaine manière, à la primauté de la forme, propre à la Gestalt-psychologie et aux sciences cognitives (système de reconnaissance en intelligence artificielle) qui ont privilégié la structure formelle dans l’appréhension des réalités empiriques.
La couleur dans le processus de perception des objets
La réhabilitation de la couleur contre le privilège exorbitant de la forme répète d’une certaine manière le débat pictural du XVIIe siècle entre partisans du dessin et avant-garde coloriste. Ce débat artistique, qui éclate dès 1648 à l’Académie des Beaux-Arts de Paris, fait s’affronter en fait deux philosophies opposées. Depuis l’Antiquité, le dessin apparaît comme canonique dans la mesure où l’essence cachée des êtres visibles se confond avec une morphologie géométrique, à fondement pythagoricien, position confirmée par le néo-platonisme, Alberti, Léonard de Vinci, etc. (Panovski, 1989 ; Klein, 1983). Au XVIIe siècle, Pacheco, émule du Greco et théoricien de la Contre-réforme commence à justifier l’importance de la couleur, seule capable de donner du relief, mais continue à privilégier le dessin « substance matérielle de la peinture et même la substance de la forme » (Magnard, 1993, p. 95 ). Il faut attendre Roger de Piles en 1668 (1989) pour voir triompher la couleur contre le dessin, le coloris exprimant en fait la véritable essence du visible, les lignes des corps pouvant être découvertes par le toucher seul (Lichtenstein, 1992, p. 169 sq et 172-173). Mais le débat esthétique se limite encore au seul point de vue subjectif de l’optique et prépare le débat du siècle des Lumières sur les vertus comparées de l’œil et du toucher dans la découverte de la véritable nature du monde extérieur, qui s’identifie à la profondeur ou troisième dimension (Merlan, 1992).
La question phénoménologique, propre au XXe siècle, est plus ambitieuse dans la mesure où il s’agit non de définir les conditions de la représentation du monde, mais les conditions primitives de sa donation au sujet. Néanmoins la philosophie ne fait plus l’économie de la perspective esthétique, et, à travers la phénoménologie, fait triompher dans l’élaboration de la question, le point de vue du vécu perceptif ; car il ne s’agit pas de statuer sur le réel abstrait, connaissable par la seule science, mais sur le sensible tel qu’il nous est donné dans le vécu de la conscience perceptive. La question de la nature du coloré fait place à celle de sa donation originaire. Dans l’ordre de l’apparaître, il n’existe pas de moindre être, tout le sensible nous est donné en même temps. Dans cette perspective, la coloration, loin d’être réductible à des propriétés physiques des molécules ou de l’optique, devient primordiale dans la reconnaissance immédiate de la chose à l’échelle du sujet existentiel. La couleur n’est pas un revêtement externe, un épiphénomène perturbateur ou inutile, mais une manière originaire d’apparaître de la chose. La couleur accède au rang de contenu eidétique pour la conscience visant le donné extérieur (Husserl, 2011). La question du statut premier ou second de la couleur est définitivement suspendue.
Mais arrivé à ce point on peut aller plus loin encore : la couleur peut être déliée de la chose qu’elle colore, libérée de sa fonction d’individuation d’un objet, pour être abordée comme émergence pure, comme qualia désobjectivée. La perception ne rencontre plus dès lors le jaune de la fleur, mais à l’occasion de la fleur, le jaune se manifestant. La couleur se retire alors dans un mode d’être se révélant, pré-objectif ou proto-ontique (Garelli,J., 1991). M. Merleau-Ponty peut ainsi isoler une dimension rayonnante universalisante, désindividualisante de la couleur : « La sensorialité : par exemple : une couleur, le jaune ; elle se dépasse d’elle-même ; dès qu’elle devient couleur d’éclairage, couleur dominante du champ, elle cesse d’être telle couleur, elle a donc de soi fonction ontologique, elle devient apte à représenter toute chose » (Merleau-Ponty, 1979, p. 271 ).
Ainsi la couleur n’est plus traitée comme un accident de la visibilité, condition plus ou moins fiable de la perception, mais ouvre sur une perception sensorielle (et non sur quelque intuition intelligible) informative, spermatique, véritable matrice de la perception de tous les objets. La perception prend appui sur une coloration antérieure aux êtres colorés, et la couleur devient une sorte de « rayon du Monde » dans la mesure où une « invisibilité » pensante, à titre de sens à conquérir, hors de toute détermination conceptuelle, se greffe sur une « visibilité », saisie en sa « singularité perceptive de couleur » (Garelli, 1991, p.121). « C’est cette animation interne, ce rayonnement du visible que le peintre cherche sous les noms de profondeur, d’espace, de couleur » (Merleau-Ponty, 1964, p. 71)
Le moment d’une systématique et d’une grammaire du sensible
L’établissement d’une autonomie de la couleur, de son dynamisme physico-psychique, n’élimine cependant pas la question d’un ordonnancement, d’une systématicité des couleurs. Car bien avant d’entrer dans un système d’objet, les couleurs font monde. Certaines couleurs s’apparient, d’autres non, mais sans reproduire les lois associatives des couleurs observées dans le monde concret. Il reste à savoir si ce monde coloré se génère lui-même, s’impose à l’esprit ou s’il est construit a priori à partir ou à travers les catégories logico-linguistiques ? (thèses de Whorf, 1971)
- L’expressionnisme abstrait d’un Kandinsky, à l’égal des théoriciens du Bauhaus, au début du XXe siècle, confère aux couleurs un pouvoir absolu, qui ne laisse aucune liberté à l’artiste : « L’artiste ne travaille pas pour mériter des louanges ou de l’admiration, ou pour éviter le blâme et la haine, mais en obéissant à la voix qui lui commande avec autorité, à la voix qui est celle de son maître devant lequel il doit s’incliner, dont il est l’esclave » (Macke, 1981, p.205) Car le peintre expérimente moins la couleur que leurs systèmes de différenciation, de contraste, d’opposition. L’essentiel n’est ni d’imiter ni d’inventer, mais de découvrir les valeurs des couleurs les unes par rapport aux autres. « Les rapports de ces formes multiples entre elles nous permettent de reconnaître chacune d’elles. Le bleu ne devient visible que par le rouge, la grandeur de l’arbre que par la petitesse du papillon », écrit August Macke (August Macke, 1981, p. 205). La grammaire des couleurs n’est donc que l’auto-production d’une multiplicité orchestrale qui doit pouvoir jouer juste.
- À l’opposé de cette dimension pré-systémique, dégagée par l’expérience de l’art non figuratif, on peut, comme Wittgenstein (1989), dans le sillage d’une philosophie analytique, s’installer d’emblée dans les opérations cognitives du sujet percevant et conditionner les rapports des couleurs entre elles par les catégories de découpage logique qui constituent un « a priori matérial » de « coloréité ». Car nous avons bien « un système des couleurs comme nous avons un système de nombres ». Si la relation « bleu-vert » fait sens, celle de « bleu-rouge » ne correspond à rien logiquement. Les exclusion et implication des couleurs ne sont ni des données de fait ni des vérités transcendantales, mais des montages grammaticaux plus ou moins arbitrairement constitués, inhérents au langage, à nos manières de dire, à nos règles du parler. Les frontières des couleurs dépendent de règles qui permettent de déterminer le sens des mots et les conditions d’usage correct du dire. « Ce sont les jeux de langage impliquant des termes de couleurs qui déterminent notre concept de couleur et, ipso facto, la “nature” des couleurs » (Chauviré, 2003).
Il reste que le langage verbal des couleurs, les jeux poétiques avec les couleurs, attestent bien que des registres grammaticaux de couleurs échappent aux règles conventionnelles d’usage qui font signification. L’orange bleue d’Eluard ne renvoie à aucune objectivité, mais met en scène un contraste coloré qui dispose bien d’une signifiance, même sans référent externe dans le monde. Il s’y joue une certaine configuration de couleur qui nous affecte et que le peintre peut traduire sur sa toile. La logique spirituelle des couleurs dépasse la grammaire pragmatique. Les couleurs sont bien inductrices de mondes possibles et différents, sans que tout y puisse arbitrairement s’y mêler. Le jeu des couleurs s’émancipe de la logique et de la langue, sans pour autant sombrer dans l’aléatoire.
On peut se demander dès lors si la phénoménalité colorée ne se tient pas dans un tiers-monde, qui n’est ni copie du seul monde empirique, ni le produit de notre structure mentale ; elle vit de sa vie propre qui s’autodéveloppe comme libre-jeu, fondement même de l’imagination créatrice.